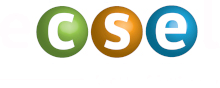Plusieurs arrêts rendus le 13 septembre 2023 méritent votre attention.
Sous l’impulsion de la justice européenne, la chambre sociale a décidé d’écarter l’application de dispositions du Code du travail qui empêchent ou limitent l’acquisition de congés payés :
- durant un arrêt de travail pour maladie « ordinaire » ou « non professionnelle »,
- en cas d’arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle,
En ce qui concerne la maladie non professionnelle
En application du Code du travail, les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue en raison d’une maladie d’origine non professionnelle ne sont pas assimilées à des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé.
En principe, un salarié n’acquiert aucun droit à CP au cours de ces périodes.
La Cour de justice de l’Union européenne a considéré que ce droit « ne peut pas être subordonné par un État membre à l’obligation d’avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit État ».
La Cour a également jugé qu’en cas de non-conformité avec ces dispositions, les juridictions nationales doivent laisser la réglementation nationale en cause inappliquée.
La Cour de cassation a dès lors estimé, le 13 septembre, qu’il convient d’écarter les dispositions du droit français qui ne sont pas conformes au droit de l’Union. Il convient de considérer que les salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison d’un arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle acquièrent des droits à congés payés durant cette période.
En ce qui concerne l’accident du travail et la maladie d’origine professionnelle
Les périodes de suspension du contrat de travail correspondantes sont assimilées par le code du travail à du temps de travail effectif. Mais dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an.
La Cour de cassation estime qu’il convient d’écarter cette limitation dans le temps.
Les salariés qui se trouvent en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle pourront acquérir des congés payés pendant toute la durée de leur absence.
Les salariés absents pour maladie (d’origine professionnelle ou non) acquièrent donc des droits à congés d’une durée identique à celle des salariés présents dans l’entreprise qui exécutent un travail effectif.
Le code du travail comporte encore les disposition que la Cour de cassation a écarté.
Il reste donc envisageable de constater que des entreprises continuent, de bonne foi ou pas, par erreur ou délibérément, à appliquer les réductions de droit en question.
Soit par erreur,
Soit parce qu’elles considéreront qu’il ne s’agit que de jurisprudence, et qu’il appartiendra au juge de se prononcer (à nouveau) en cas de litige….si litige il y a…donc si le salarié expose une demande de régularisation à l’employeur.
Espérons que, pour clarifier définitivement la situation, le législateur modifie le code du travail pour se conformer à la jurisprudence.
Dans cette attente, les salariés sont appelés à la vigilance, tout comme leurs représentants.
Les congés payés sont en effet soumis à une prescription triennale dont le point de départ est l’expiration de la période de prise des congés.
La Cour de cassation a précisé, le 13 septembre, que la prescription ne peut commencer à courir que si l’employeur a pris les mesures nécessaires pour permettre au salarié d’exercer effectivement son droit à congés payés.
Il doit justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombaient légalement.
Dans les entreprises confrontées à un taux d’absentéisme important, il y a fort à parier que ces arrêts auront des conséquences significatives : la régularisation des droits à CP risque d’avoir un impact très important.
Si les régularisations sont effectuées…
Nous sommes à votre disposition pour vous aider à préparer les débats relatifs à ce sujet
A minima, le CSE devrait poser les questions suivantes :
Veuillez vous identifier ou vous inscrire pour lire la suite...